Les serments jusqu'au grade de Maître
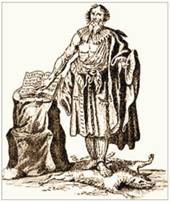
Le serment qui traduit la force de l’engagement est probablement l’un des actes les plus graves auquel nous pouvons être confrontées. Au cours de notre parcours maçonnique, nous sommes appelées par trois fois à prêter serment, et la dramaturgie comme le contenu de chaque obligation est à la fois solennel et terrifiant.
L’engagement maçonnique est très ancien puisque on en trouve déjà la trace dans l’ordonnance de la Cathédrale d’York de 1370 où les obligations des maçons travaillant à l’église Saint-Pierre sont énumérées avec une précision qui se retrouvera en 1390 dans le Régius étendant l’obligation à tous les maçons du royaume.
Dans les loges écossaises apparues dès 1598 les maçons partageaient des « secrets », et notamment celui du « mot du maçon » qui leur était communiqué après qu’ils avaient prêté serment de discrétion. Ensuite le serment sera repris dans tous les textes constitutifs de la F\ M\ spéculative, et il est toujours prêté dans les différents rites pratiqués aujourd’hui.
Énoncer et prononcer un serment le fait pénétrer dans notre conscience le transforme en principe et lui confère une substance. Du premier au troisième grade, nous nous sommes engagées à haute voix devant une assistance qui a reçu notre promesse et pourra en être le cas échéant et le témoin et le juge.
Lorsque le soir de mon initiation la V\ M\ a annoncé le moment du serment, je ne me suis pas posé la question du pourquoi, mais celle du contenu craignant que quelque chose puisse être contraire aux Lois de la République. Une fois rassurée sur ce point, je me suis sentie légère pour m’engager, et pas plus que les sentences du cabinet de réflexion ne m’avaient effrayée, le contenu du serment ne m’a rebutée.
Quel que soit le degré, c’est à l’autel des serments que se prêtent les obligations. Lors de la cérémonie d’initiation, le serment est double. Le premier se prête avant le début des voyages tandis que la coupe des libations est proposée aux néophytes. Debout, la coupe dans la main gauche, la main droite sur le cœur, attitude qui dans la symbolique chrétienne est celle de la franchise et de la droiture. Et n’est-ce pas cela qui est demandé lors de la prestation de serment ? Une franchise totale, absolue, soulignée dans le serment du 2ème degré par la partie de phrase où il est dit « sans équivoque et sans réserve mentale ».
La franchise est une des vertus cardinales que nous devons cultiver. Être franc, c’est être libre. Nous nous engageons dans la liberté, cette liberté essentielle pour notre démarche initiatique. Et pourtant, prêter serment, c’est faire allégeance, c’est donc renoncer à une liberté. Ce qui pourrait paraître paradoxal ou ambivalent ne l’est pas vraiment.
La F\ M\ est à la fois un idéal qui ouvre les voies d’une vision intérieure et d’une liberté de pensée, qui ne sauraient être volées à celles ou ceux qu’elles habitent et un ordre initiatique qui nous engage sur une voie nouvelle et nous pousse à découvrir et à mettre en œuvre nos virtualités par un long travail intime dont le rite est le révélateur et le soutien.
La dramaturgie au 1er degré est particulièrement appuyée, et répond à la nécessité de marquer très fortement l’engagement initial qui sera ensuite répété et renforcé par les serments accompagnant les deux autres cérémonies. Les conditions de l’obligation ne sont donc anodines ni dans leur forme, ni dans leur contenu.
Un serment est sacré par lui-même, en F\ M\ on peut dire qu’il l’est doublement, et que la force de nos serments tient aussi au fait qu’ils sont prononcés sur les trois Grandes Lumières de la F\ M\, et particulièrement, au REAA, sur le volume de la Loi Sacrée.
L’équerre et le compas présents dans de nombreuses traditions symbolisent les outils inséparables de toute construction dédiée, quel que soit son nom, à un Principe supérieur. Ainsi retrouve-t-on le compas entre les mains de Saint Thomas ou de Jésus, comme dans celle de l’architecte céleste Vishvakarma.
Parlant des origines de la géométrie, Michel Serres écrit : « La géométrie sommeillait sous la terre ou rêvait dans l'éclat du Soleil, le gnomon des anciens Grecs et des Babyloniens l'a peu à peu réveillée le long des formes singulières communes à l'ombre et à la lumière ».
Par l’équerre, signe du « gnomon », symbole pythagoricien, se fonde le temple de la terre, celui des pierres vives, tandis que de son union avec le compas naît l’Ordre organisant le chaos.
Ainsi la rectitude et la rigueur de l’équerre s’ajoute-t-elle à la dynamique spirituelle du compas, et leur union se concrétise-t-elle avec le Volume de la Loi Sacrée, livre décrivant une cosmogénèse évoquant un Principe créateur.
Est-ce à dire qu’en cas de manquement au serment, la punition sera double ? En général, le parjure s’accompagne du mépris et du déshonneur. En F\ M\, les serments sont assortis d’un signe pénal contenant chacun une terrible violence, ces signes se font à la gorge, au cœur et au ventre et correspondent à 3 des 7 chakras (1). Ces trois régions du corps concentrent l’énergie et la force vitale, les capacités d’aimer et de rayonner, la parole et la conscience individuelle et collective.
Mais de qui recevrons-nous ces punitions en cas de manquement à nos serments ? De nous-mêmes ? De nos sœurs ou frères ?
Nos serments sont au moins de trois ordres :
- L’un se rapporte à ne rien révéler de ce qui se passe en Loge. Je l’appellerai plan primaire qui consiste à taire à ceux qui ne doivent en avoir connaissance le fonctionnement d’un atelier ou les secrets d’un grade.
- Le second est le plan fraternel, il consiste à aimer et respecter l’autre, à le secourir, à demeurer juste et équitable, comme l’équerre.
- Le troisième est le plan spirituel, celui de l’expérience initiatique partagée, celui de l’incommunicable parce qu’inexprimable.
La F\ M\ nous ouvre les voies de notre propre conscience, mais ne nous impose aucun chemin. Chacun de nous s’avance à sa manière, à son rythme, chacun de nous reçoit le message initiatique de manière personnelle et le vit de façon différente ce qui fait qu’il n’est susceptible d’aucune interprétation dogmatique qui serait la même pour tous.
Si nous manquons au premier de ces trois plans, nos sœurs et nos frères peuvent nous en tenir rigueur et nous demander des comptes. Si nous manquons au second, c’est à nous-mêmes que nous devons faire face, mais devant qui répondre en cas de manquement au troisième ? Et d’ailleurs de quel manquement pourrait-il s’agir, puisque sa nature même le rend indicible ?
Alors, pourquoi tous ces serments ? Et pourquoi un tel caractère et solennel et sacré ?
Que ce soit le mot grec
« orkos », ou le mot latin
« sacramentum »,
l’étymologie du mot serment, nous
ramène à un dépôt fait aux
dieux, en guise de bonne foi. Le manquement au serment ne peut donc se
faire que devant cette même Autorité. Sur ce
point, René Desaguliers s’interroge :
« Et quelle peut-être une telle
autorité, sinon un dieu ou le Dieu unique ? »
Mais revenons au caractère du serment : il est de nature sacrée puisqu’il se prête sur le Volume de la Loi Sacrée, dans ce cas ce n’est plus devant nos pairs que nous pouvons répondre d’un manquement mais devant quelque chose qui nous dépasse et nous transcende. Nous entrons librement en F\ M\, par nos serments nous adhérons aux principes et aux idéaux qu’elle nous propose, les trahir c’est nous trahir nous-mêmes, révéler ce que nous devons garder secret c’est enfreindre une Loi que nous avons reconnue comme sacrée. Le premier tribunal sera celui donc de notre conscience, le second celui de l’immanence.
Cela conduit à nous interroger sur le pourquoi des serments ?
En refusant de céder aux trois mauvais compagnons, Hiram délivre un message moral, celui de l’homme qui sacrifie sa vie pour ne pas trahir le secret dont il est dépositaire. Hiram devient donc un modèle dont il faut s’inspirer ;
Au-delà, nous trouvons un message symbolique celui déjà rencontré avec Shibboleth, symbole du cycle où se succèdent la mort et la renaissance. Comment le maître pourrait-il renaître s’il ne meurt pas au préalable ?
Mais plus loin encore, un message initiatique, puisqu’au cours de la cérémonie d’élévation à la maîtrise nous incarnons tour à tour les mauvais compagnons et le maître assassiné, c’est-à-dire qu’avant de pouvoir prétendre nous engager dans notre quête, nous devons nous purifier jusqu’à tuer en nous tout ce que nous portons de mauvais pour espérer « reparaître aussi radieux que jamais ».
Mais une autre voie de réflexion ne peut être négligée.
Que serait-il advenu sans la mort d’Hiram ? Si l’on part de l’idée que dans le serment le pire est le parjure et que les trois degrés maçonniques nous conduisent au meurtre d’Hiram, meurtre nécessaire, puisque l’idée de vaincre la mort en mourant et en ressuscitant est la finalité de l’enseignement, alors les trois mauvais compagnons peuvent être considérés d’une autre manière : par eux le Maître meurt, mais grâce à eux le nouveau Maître reparaît. La cérémonie du 3ème degré repose sur cette articulation, qui elle même repose sur la substitution du mauvais en bon compagnon. Cet artifice nous permet également de comprendre à quel point il nous est nécessaire de changer en profondeur si nous voulons réellement espérer avancer dans notre quête, car c’est d’abord au fond de nous que nous devons tuer l’ignorance, le fanatisme et l’ambition.
Dans cette perspective, les trois mauvais compagnons deviennent les passeurs nécessaires, ils remplissent un devoir et permettent au nouveau maître de s’approprier les vertus d’Hiram, dont le meurtre peut alors être considéré comme un sacrifice rituel.
T\ R\ V\ M\, j’ai dit.
A\ M\
Note :
(1) Chakras, nom Sanscrit des centres
énergétiques appelés aussi centres
psychiques, centres d'éveil, portes de la conscience, ou
vortex, en Occident.